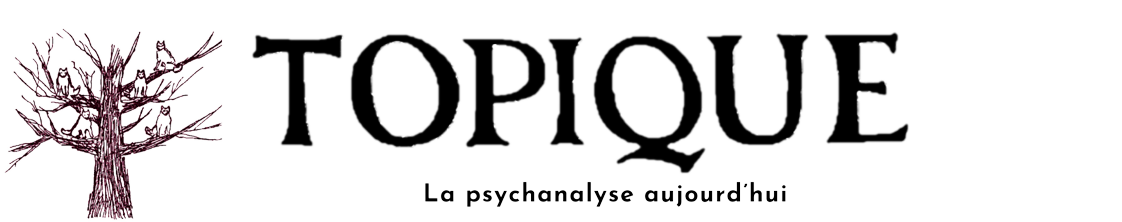Théories de la violence, politiques de la mémoire et sujets de la démocratie
S?agissant des théories de la violence, il est clair que les modèles philosophiques élaborés pour en rendre compte sont aujourd?hui épuisés, ou, à tout le moins, à questionner : le modèle juridico-étatique, où seul l'Etat détient la violence légitime (Max Weber, Habermas) ; le modèle révolutionnaire, où la violence est pensée comme réponse à une violence antérieure de classe (Marx critique de Hegel) ; le modèle néo-libéral, où la violence est sans cause assignable, sinon celle de l'incapacité des « victimes » à s?adapter (Hayek). S?agissant des formes nouvelles de la violence, il faudra aussi au moins interroger la peur généralisée de l'autre, ou crainte anticipée de la violence, l'exclusion comme « production de l'homme jetable», la violence suicidaire des émeutes urbaines et les violences ethniques liées aux diverses manifestations du nationalisme. La question de la violence, liée à celle de la mémoire et de la réparation, engagerait donc directement la notion de la subjectivation politique, c?est-à-dire celle de la citoyenneté et de la communauté. Comment ne pas annuler la politique dans la relation entre un état social et un état du dispositif étatique, et dans le consensus, qui est le contraire de la démocratie, si on veut bien celle-ci définir comme lien de la division et libre expression du dissensus ?
Mots-clés
- Consensus/dissensus
- Démocratie
- Mémoire
- Modèles de la violence
- Sujetpolitique